Home > Top 5 Erreurs Fréquentes en Gestion de Projet – et Comment les Eviter
La gestion de projet ne se résume pas à un diagramme de Gantt ou à des réunions régulières. C’est une discipline exigeante qui vise à aligner des objectifs clairs, des ressources limitées et des parties prenantes souvent divergentes. Pourtant, même dans un contexte structuré comme celui des entreprises suisses, les difficultés persistent.
Selon McKinsey, les grands projets IT dépassent en moyenne de 45 % leur budget initial et livrent jusqu’à 56 % de valeur en moins. Le PMI souligne de son côté que les organisations disposant d’une culture projet mature et d’équipes formées atteignent des taux de réussite nettement supérieurs. Cet article propose un panorama des 5 erreurs les plus fréquentes en gestion de projet et des méthodes concrètes pour les anticiper et les éviter durablement.

L’absence de cadrage précis constitue la première cause d’échec en gestion de projet. Un objectif mal formulé entraîne des incompréhensions, des attentes contradictoires et, à terme, des dépassements de coûts et de délais. Selon le Standish Group, près de 39 % des projets échouent en raison d’objectifs flous ou de périmètres changeants. En Suisse comme ailleurs, cette erreur reste fréquente, notamment dans les environnements où la culture projet est encore en développement.
Un cadrage solide repose sur trois fondations : des objectifs SMART (spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels), une matrice RACI clarifiant les rôles et responsabilités, et des livrables définis avec des critères d’acceptation validés par les parties prenantes. Dans une entreprise romande du secteur industriel, la formalisation de ces éléments a permis de réduire de moitié la durée de validation finale d’un projet numérique. Cette clarté initiale favorise la confiance, réduit les malentendus et accélère les prises de décision.
Il convient également de se prémunir contre le biais d’optimisme, tendance naturelle à sous-estimer la complexité et à surestimer les capacités d’exécution. Comme le rappelle la Harvard Business Review, introduire des revues externes ou des marges de sécurité dès le cadrage renforce la fiabilité du plan projet. En d’autres termes, mieux vaut un objectif réaliste que des ambitions irréalisables.

L’une des erreurs récurrentes consiste à présumer que tout se déroulera comme prévu. Pourtant, selon une étude conjointe de McKinsey et Oxford, 70 % des projets informatiques dépassent les délais initiaux. Cette dérive est souvent liée à une évaluation incomplète des risques ou à une planification trop optimiste.
Une démarche rigoureuse d’analyse des risques permet d’éviter bien des déconvenues. L’usage d’une matrice des risques, mise à jour à chaque jalon du projet, aide à identifier les menaces selon leur probabilité et leur impact. Les risques doivent être répartis en trois catégories : techniques (sécurité, dette technique), organisationnels (disponibilité des ressources, gouvernance), et externes (réglementation, dépendances fournisseurs). Chaque risque se voit attribuer un responsable, des signaux d’alerte précoces et un plan de mitigation. Cette approche pragmatique a par exemple permis à une administration cantonale de détecter un risque RGPD majeur avant le déploiement d’un portail citoyen, évitant des correctifs coûteux.
Prévoir un plan de contingence et des marges de sécurité budgétaires n’est pas une marque de pessimisme, mais de professionnalisme. Comme le souligne le PMI Pulse of the Profession 2024, les organisations qui intègrent des marges planifiées réduisent en moyenne de 26 % leurs dépassements de délais.
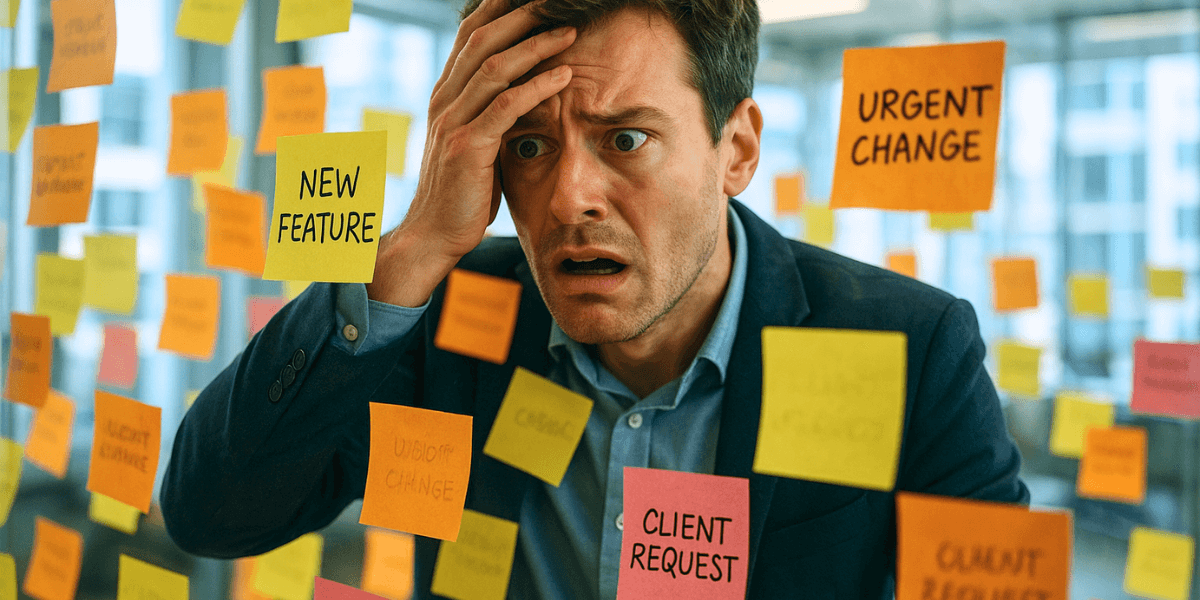
Une communication insuffisante ou mal structurée demeure un facteur majeur d’échec. Le rapport Gallup indique que près de la moitié des collaborateurs estiment ne pas recevoir les informations nécessaires à leur travail. Une communication fragmentée entraîne des doublons, des retards et une perte de sens collectif.
Un plan de communication projet clair définit les canaux, les fréquences et les acteurs concernés. Il s’appuie sur des rituels légers mais réguliers : points d’avancement, réunions de synchronisation ou comités de pilotage ciblés. Dans un programme de transformation bancaire genevois, la mise en place d’un suivi hebdomadaire sponsor–chef de projet a permis d’accélérer les arbitrages et de diviser par deux les délais de décision. Ce type de structure favorise la transparence, la traçabilité et la réactivité.
La communication est également une question de gouvernance. Des circuits décisionnels clairs et une documentation des échanges évitent les malentendus. Comme le rappelle Forbes, la majorité des projets échouent non pas pour des raisons techniques. Mais souvent pour des défaillances dans la circulation de l’information.
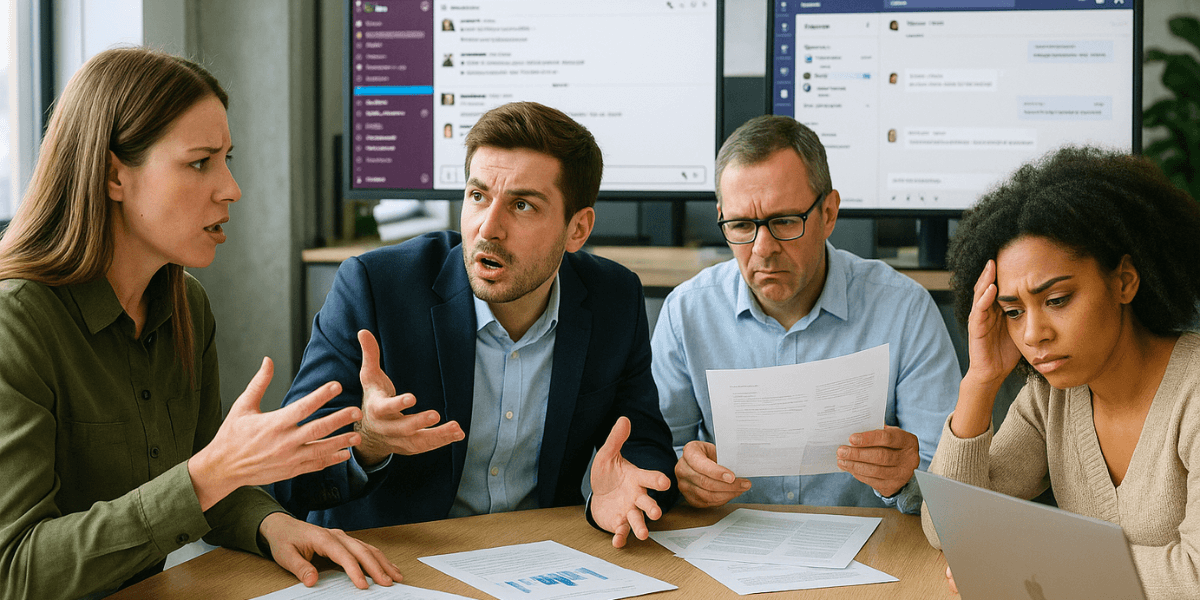
L’ajout progressif de fonctionnalités ou de demandes non prévues est un phénomène bien connu : le scope creep. Ce glissement insidieux résulte souvent de demandes ponctuelles non cadrées ou de décisions informelles. Le PMI identifie cette dérive comme l’une des principales causes de dépassement budgétaire.
Pour le maîtriser, chaque demande d’évolution doit être enregistrée, évaluée et validée selon un processus transparent. La mise en place d’un registre des changements documente la nature de la demande, son impact et la décision finale. Dans une entreprise technologique lausannoise, cette pratique a permis de réduire de 30 % les modifications hors périmètre en quelques sprints. Comme le souligne également le PMI, dire « non » ou « plus tard » n’est pas un refus, mais un acte de pilotage responsable.
Dans le contexte suisse, où la satisfaction du client interne ou externe est une priorité culturelle, cette discipline est essentielle pour préserver la viabilité des projets. Le contrôle du périmètre n’est pas une contrainte : c’est une condition de succès.
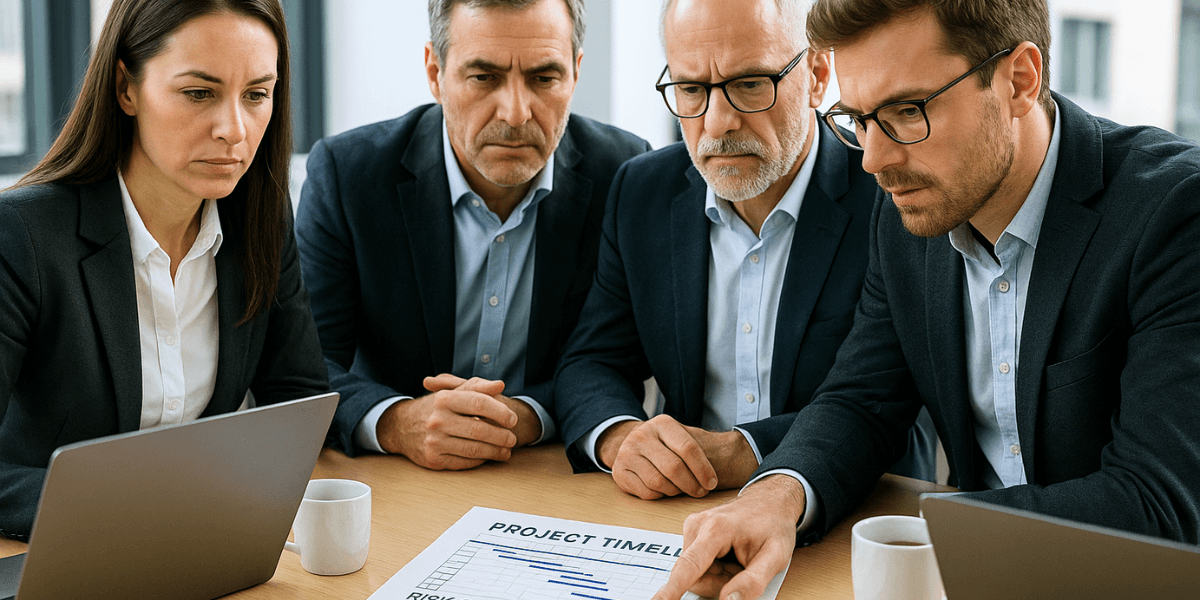
Derrière chaque projet se trouvent des équipes, et leur engagement influence directement la réussite. Selon Gallup, les organisations qui favorisent l’engagement des collaborateurs sont 21 % plus performantes. Pourtant, dans la pratique, la pression sur les délais ou la focalisation technique relèguent souvent l’humain au second plan.
Valoriser les contributions, maintenir des échanges ouverts et instaurer un climat de confiance sont des leviers de performance durable. Dans un projet de refonte CRM mené dans une société zurichoise, la création d’espaces de feedback et la reconnaissance systématique des réussites ont permis de stabiliser la productivité et de réduire le turnover. Ces initiatives relèvent davantage de la posture managériale que de la méthodologie, mais leur effet est décisif.
Le rôle du sponsor est également central : un soutien visible et une communication régulière renforcent la motivation et la cohésion d’équipe. La réussite d’un projet repose autant sur la qualité du pilotage que sur la qualité du climat de travail.

Plusieurs dimensions souvent négligées méritent une attention particulière dans la gestion de projet. Parmi elles figurent les biais cognitifs tels que le biais d’ancrage, d’optimisme ou de récence qui influencent inconsciemment la planification et la prise de décision. Reconnaître leur existence permet d’adopter des approches plus rationnelles.
La maturité organisationnelle joue également un rôle majeur. Les entreprises et institutions qui disposent de processus clairs. D’une gouvernance cohérente et d’une culture de collaboration maîtrisent mieux les dérives de périmètre et les retards. En Suisse, l’adoption de cadres méthodologiques comme HERMES ou de modèles hybrides. Mêlant agilité et planification structurée favorise cette stabilité et renforce la performance collective.
Enfin, la capitalisation des retours d’expérience constitue un levier de progrès souvent sous-exploité. Les revues post-projet permettent d’analyser les réussites, d’identifier les axes d’amélioration et de transmettre les enseignements aux équipes futures.

La prévention des erreurs de gestion de projet repose sur une approche globale. Quatre leviers essentiels se dégagent :

Les erreurs de gestion de projet sont inévitables, mais elles peuvent être anticipées. Des objectifs précis, une gestion active des risques, une communication structurée, un périmètre maîtrisé et une attention constante à la dimension humaine constituent les piliers d’une exécution réussie. Les organisations qui intègrent ces pratiques développent une véritable culture de la performance projet, fondée sur la clarté, la collaboration et l’apprentissage continu. La rigueur ne limite pas la créativité : elle en garantit la concrétisation.
Quelle est la principale cause d’échec d’un projet ?
La plupart des échecs découlent d’objectifs mal définis ou d’un manque de cadrage initial. Des objectifs SMART et un périmètre validé sont essentiels.
Comment réduire les risques de dépassement de délais ?
Prévoir des marges réalistes, identifier les risques critiques dès le départ et les suivre à chaque jalon permet de mieux maîtriser les délais.
Qu’est-ce que le scope creep et comment le contrôler ?
Le scope creep désigne l’ajout progressif d’éléments hors périmètre. Un registre de changements documenté et validé par le sponsor est la meilleure protection.
Pourquoi la communication est-elle si cruciale ?
Elle assure la cohérence entre équipes, accélère la prise de décision et renforce l’engagement. Une communication claire est un facteur clé de réussite.
Quelle méthode adopter pour améliorer la culture projet ?
Une approche hybride mêlant rigueur méthodologique (PRINCE2, PMP) et agilité (Scrum, Kanban) est souvent la plus adaptée aux organisations modernes.
McKinsey — Delivering large-scale IT projects on time, on budget and on value ; PMI — Future of Project Work ; Standish Group — CHAOS Report 2020 ; PMI — Top Five Causes of Scope Creep ; PMI — Controlling Scope Creep ; HBR — The Planning Fallacy and the Illusion of Control ; Gallup — State of the Global Workplace ; Forbes — Poor Communication Is Still the Primary Contributor to Project Failure.

Nos dernières publications
S’abonner à la Newsletter
Consultez nos formations et sessions confirmées

Nous utilisons des cookies afin de vous garantir une expérience de navigation fluide, agréable et entièrement sécurisée sur notre site. Ces cookies nous permettent d’analyser et d’améliorer nos services en continu, afin de mieux répondre à vos attentes.
ITTA
Route des jeunes 35
1227 Carouge, Suisse
Monday to Friday
8:30 AM to 6:00 PM
Tel. 058 307 73 00
ITTA
Route des jeunes 35
1227 Carouge, Suisse